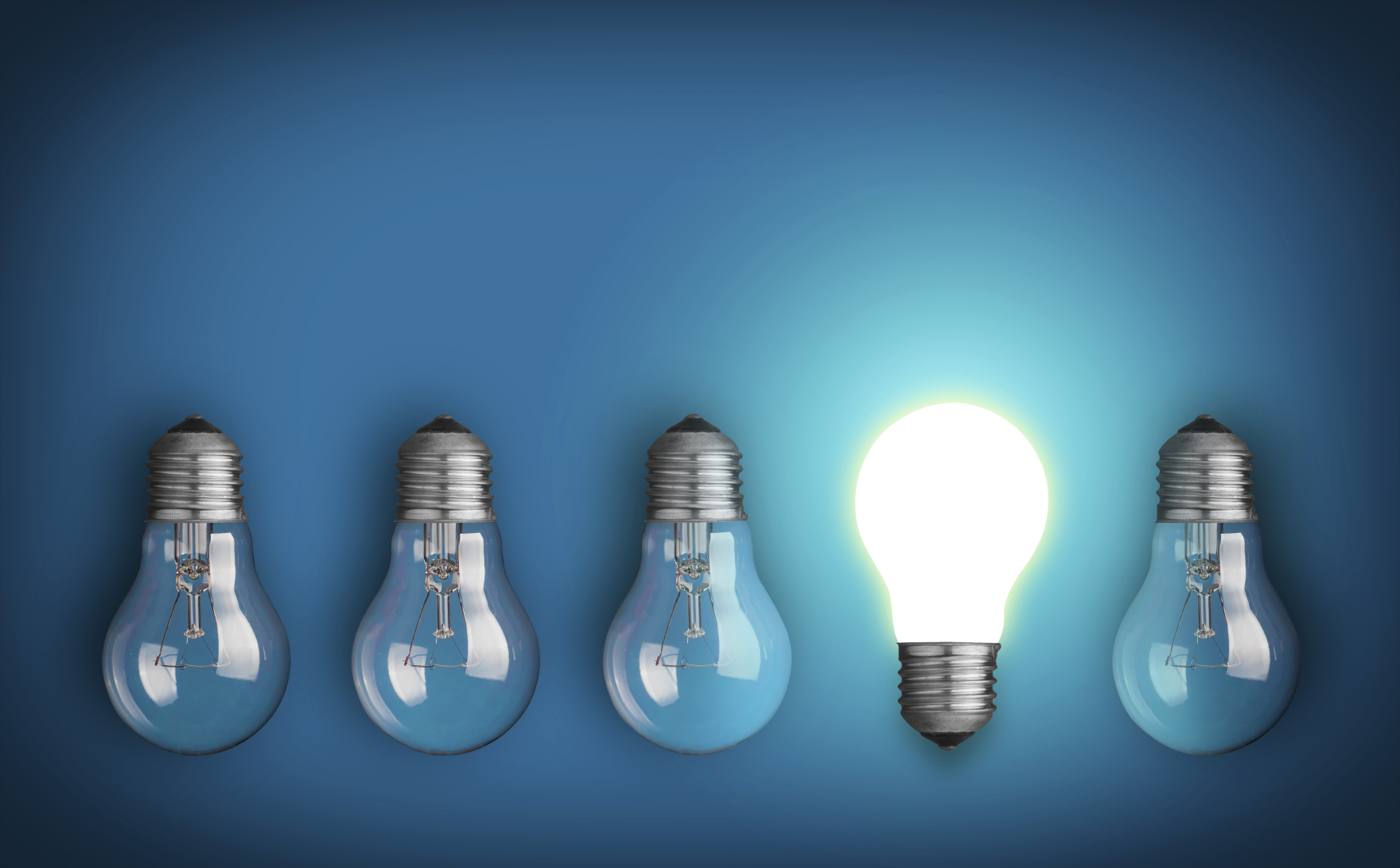Article publié initialement sur le blog de l’IFACI:
« Le simple calcul nous dissuaderait d’investir, si le goût du risque n’était pas inscrit dans la nature humaine » (John Maynard Keynes).
Bien que la notion de gestion des risques soit très ancienne[1] et initialement plutôt l’apanage des assureurs et des banquiers, elle occupe une place sans cesse croissante dans le vocabulaire managérial, politique et institutionnel. Cette incursion massive de la gestion du risque dans la société se traduit de plusieurs manières très concrètes. Tout d’abord, la fonction de « risk manager » connaît une croissance forte au sein des entreprises. Par ailleurs, de nombreux référentiels de gestion des risques ont émergé, comme en témoigne le tableau accessible à l’adresse suivante (liste non exhaustive): https://www.evernote.com/l/AEw82KmfusFDBrNOkCU1lU3n93ymXe4tnPM
D’un point de vue législatif et réglementaire, les notions de « risque » et de « gestion des risques » ont également connu des développements significatifs sur une relative courte période. Les principaux textes, particulièrement importants selon nous (dans le contexte français) sont accessibles à l’adresse suivante: https://www.evernote.com/l/AEzmPjMq7WFAIIT04mp0WPh6hSz5zKet1h4
La multiplication des textes et des référentiels, ainsi que la place significative qu’occupe actuellement le risque dans de nombreux débats[2] suscite depuis quelques années l’inquiétude de plusieurs entrepreneurs, économistes, scientifiques et politiques. On citera par exemple Jaques Attali, dans Perspectives Economiques, qui écrit que « les sociétés les plus riches ne veulent plus courir le moindre danger, ni pour traverser a rue, ni pour vendre un objet…c’est partout l’objectif risque-zéro[3] ». Le Sénat s’est également penché sur ce sujet avec force de détail en juillet 2012 au travers d’un rapport intitulé « l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques[4] », qui affirme notamment (au sujet du principe de précaution), que « poussé à l’extrême, celui-ci requiert l’exigence de preuve de l’inexistence d’un danger, et donc de la connaissance totale et parfaite d’un produit, connaissance utopique et frein à l’innovation. ».
Certes, et comme le soulignent de nombreuses normes, le risque ne doit pas être envisagé que sous le prisme du « danger ». S’il est parfois fait référence aux opportunités lorsque la notion de risque est évoquée, il faut reconnaître toutefois que cette connotation positive reste très marginale dans son usage courant. Ainsi des voix commencent à s’élever pour dénoncer une société qui deviendrait « trop averse » à la prise de risques[5], arguant qu’une telle évolution restreint la capacité d’innovation ou au mieux la ralentit.
Avant de poursuivre notre réflexion, il est ici important de revenir sur une distinction fondamentale : celle qui distingue le « risque » de « l’incertitude ». La Documentation française[6] précise en effet que « les agents se trouvent en situation d’incertitude lorsqu’ils ignorent ce que sera leur environnement dans un avenir proche ou lointain. Knight et Keynes distinguent le risque, situation pour laquelle on peut dresser la liste de toutes les éventualités et leur attribuer une probabilité de réalisation et l’incertitude, situation pour laquelle l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas vérifiée. » Cette distinction est capitale car la majorité des débats contemporains relatifs à la gestion de l’impact négatif d’évènements futurs sur la capacité d’innovation se focalisent sur le principe de précaution, dont l’objet est la gestion de l’incertitude et non la gestion des risques.
Il est vrai que la gestion des risques (la gestion d’événements dont on est capable d’évaluer la probabilité et l’impact) peut parfois être sources de dérives contre-productives, appréciées principalement via le prisme d’un rapport coût/bénéfice défavorable. Ceci est particulièrement vrai pour les risques qui :
- i) touchent à la sécurité physique des individus[7],
- ii) peuvent avoir une dimension politique importante (ex : risque terroriste, risque épidémique),
- iii) attirent l’intérêt des médias (ex : les noyades de l’été 2013[8]),
- iv) sont « manufacturés » (c’est à dire issues de l’activité humaine) et peu « contrôlables » par les personnes qui y sont exposées (ex : le risque nucléaire, les OGM, les accidents d’avion…)
Nous pensons cependant que ces dérives trouvent leur origine, dans la majorité des cas, dans un risque dont la quantification est extrêmement complexe, voire impossible, ce qui le ramène alors à l’état d’incertitude[9] ; état qui l’exclue par définition du domaine de la « gestion des risques » telle qu’elle est entendue par le COSO. En effet, un risque majeur qui ne peut pas être probabilisé entre dans le champs de la gestion du principe de précaution, formalisé dans l’article 5 de la charte de l’environnement et qui dispose que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Or c’est bien ce dernier qui fait aujourd’hui l’objet d’intenses débats au sein de la communauté scientifique, juridique, économique et politique, au regard de son impact potentiellement négatif sur l’innovation. De notre point de vue, et sur un plan purement opérationnel[10], la gestion d’une incertitude (et donc la mise en œuvre du principe de précaution) peut se gérer de deux manières : soit on évacue le problème en l’évitant, soit on adopte une démarche de « testing » progressive dont les résultats sont évalués scientifiquement par des personnes/autorités indépendantes.
Dans le cas de l’évitement, il peut être extrêmement difficile, voire impossible, de revenir en arrière tant la mise en place d’une chaîne industrielle peut s’avérer coûteuse. Un exemple relativement célèbre est celui des « terres rares ». Ces dernières, aujourd’hui essentielles pour le secteur technologique, ont bien été produites en Europe au début du XXème siècles[11], mais jugées trop polluantes, il a alors été décidé d’arrêter complètement cette filière industrielle. On connaît la suite de l’histoire (on estime qu’il faudrait environ 20 ans pour remonter cette filière en France).
Dans le cas du « testing » (ex : test sur une région limitée géographiquement des processus d’extraction du gaz de schiste), ce dernier peut être une stratégie pertinente, à condition d’y consacrer suffisamment de moyens et de ne pas perdre de vue que la célérité sera un facteur clé de succès : si vous mettez trop de temps à innover, quelqu’un le fera sans doute à vote place ! Par ailleurs il est important de toujours garder à l’esprit que les difficultés que vous rencontrerez en chemin (ex : caractère polluant des extractions) peuvent être la source d’innovations « disruptives » génératrices d’opportunités.
Afin de ne pas freiner outre mesure les capacités d’innovation, il conviendrait donc sans doute de se pencher en priorité sur la mise en œuvre d’une gestion « intelligente » du principe de précaution[12], plutôt que d’accabler les dispositifs de gestion des risques, largement perçus par les entreprises comme concourant au développement maîtrisé de leurs activités. Il est vrai que le défi à relever n’est pas simple: il implique notamment l’absence d’une vision dogmatique des incertitudes et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation importantes afin de réduire l’écart entre la perception de ces dernières par la population et leur réalité, thème chère à Peter Sandman[13].
De notre point de vue, la question centrale en matière de gestion des risques, ce que l’on pourrait qualifier de « risque du risque », n’est pas tant son impact potentiel sur le processus d’innovation, que l’émergence potentielle d’un aléa moral systémique permise par des stratégies de gestion toujours plus innovantes et nombreuses[14] et dont on a commencé à ressentir les effets depuis la crise débutée en 2007 : quand on ne sait plus qui « porte » le risque, ce dernier se rappelle à vous de manière parfois violente…
[1] Le terme aurait une origine latine « resecare » qui signifierait « écueil » ou « récif ». Le terme aurait été utilisé pour la première fois par des marins pour désigner un évènement dont l’impact serait donc plutôt négatif…
[2] OGM, risques nucléaires, risques liés aux ondes…
[3] Une étude effectuée par le Sénat a démontré que pour la majorité des gens, la notion de « risque-zéro » n’existe pas mais qu’il faut tout faire pour s’en rapprocher.
[4] Rapport n° 286 (2011-2012) de MM. Claude BIRRAUX, député et Jean-Yves LE DEAUT, député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, déposé le 24 janvier 2012, disponible à : http://www.senat.fr/rap/r11-286-1/r11-286-1.html. Voir également le rapport d’étape de l’assemblée nationale relatif à la mise en œuvre du principe de précaution disponible à : http://www.assemblee-nationale.fr/13/controle/com_cec/cec-pdf/rapport_etape_principe_precaution.pdf
[5] Le sociologue Beck baptise les sociétés contemporaines « sociétés du risque ».
[6] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
[7] On citera notamment les débats qui ont émergé en 2013 au regard de l’interdiction faite aux mineurs de travailler en hauteur (voir : http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/16/20005-20140316ARTFIG00094-ce-decret-qui-priverait-les-jeunes-saisonniers-d-escabeau.php).
[8] Voir l’article du Monde : http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/08/05/un-nombre-de-noyades-pas-plus-important-en-2013_3457494_3238.html
[9] Un risque non quantifiable est un risque non assurable : c’est pour cette raison que de nombreuses polices d’assurance excluent par exemple le risque nucléaire et les OGM de leurs polices.
[10] L’auteur n’a pas la prétention de maîtriser les débats philosophiques, scientifiques et juridiques très complexes relatifs à la mise en œuvre du principe de précaution.
[11] Certaines des techniques relatives à l’exploitation de ces terres rares ont même été inventées par des français (Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran et Georges Urbain) au début 19ème siècle.
[12] Ce que prônent l’assemblée nationale et le sénat au travers de différents rapports.
[13] Auteur de nombreux travaux sur ce sujet. Voir : http://www.psandman.com/
[14] On estime ainsi par exemple que le montant notionnel des produits dérivés (un instrument de transfert des risques financiers) dans le monde a dépassé les 700 000[14] milliards de dollars, suivant une progression exponentielle depuis la fin des années 90 – Source BRI.